Prix Antoine-Grégoire – Appel de candidatures 2024
Le Prix Antoine-Grégoire est un Prix Hommage en l’honneur du fondateur de l’ATUQ. M. Grégoire a été, entre autres, directeur général de la Société de transport de l’Outaouais de 1980 à 1995. Il a été sacré Grand citoyen de Gatineau en 2006. Il est décédé en 2010 à l’âge de 85 ans.
 Le prix qui porte son nom est remis annuellement par l’ATUQ à une personne œuvrant ou ayant œuvré au cours de sa carrière, pendant une période significative, dans le domaine du transport collectif au Québec, soit au sein d’un organisme de transport, d’un organisme connexe, ou qui a contribué de façon appréciable à l’évolution de la mobilité urbaine et/ou à sa promotion.
Le prix qui porte son nom est remis annuellement par l’ATUQ à une personne œuvrant ou ayant œuvré au cours de sa carrière, pendant une période significative, dans le domaine du transport collectif au Québec, soit au sein d’un organisme de transport, d’un organisme connexe, ou qui a contribué de façon appréciable à l’évolution de la mobilité urbaine et/ou à sa promotion.
Pour toute question ou pour soumettre une candidature, veuillez communiquer avec l’équipe du colloque au colloque@atuq.com.
Récipiendaire 2023
M. Jean-Jacques Beldié
Ex-président de l’ATUQ (2001 à 2013) et de la STL (1991 à 2013)


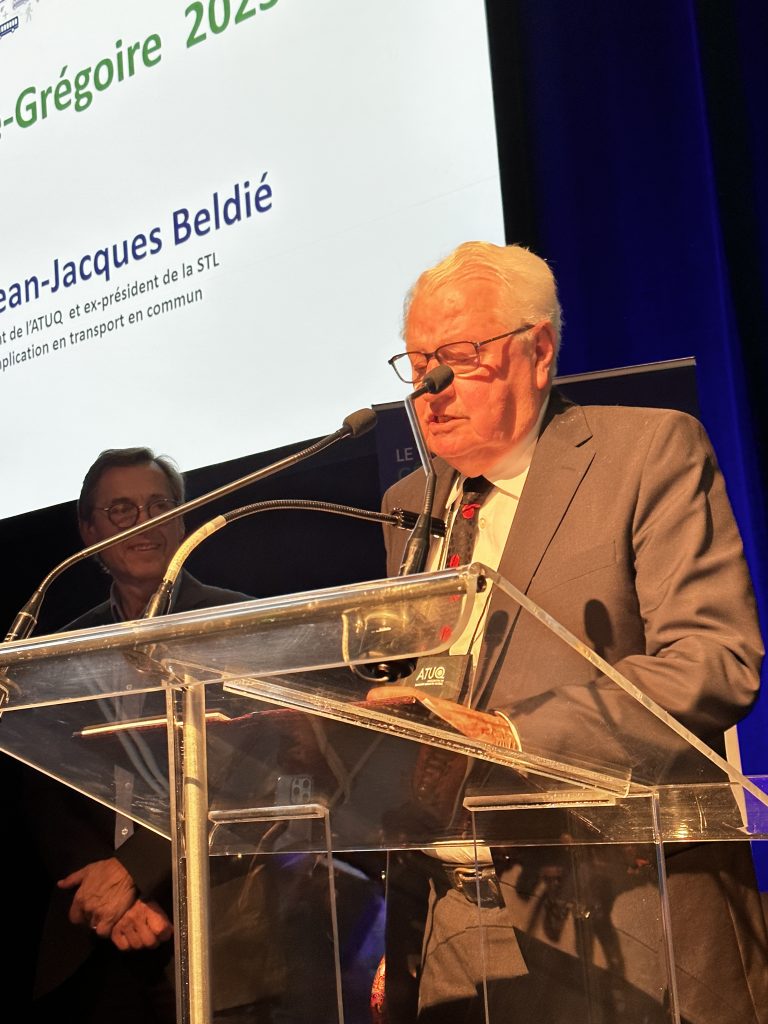
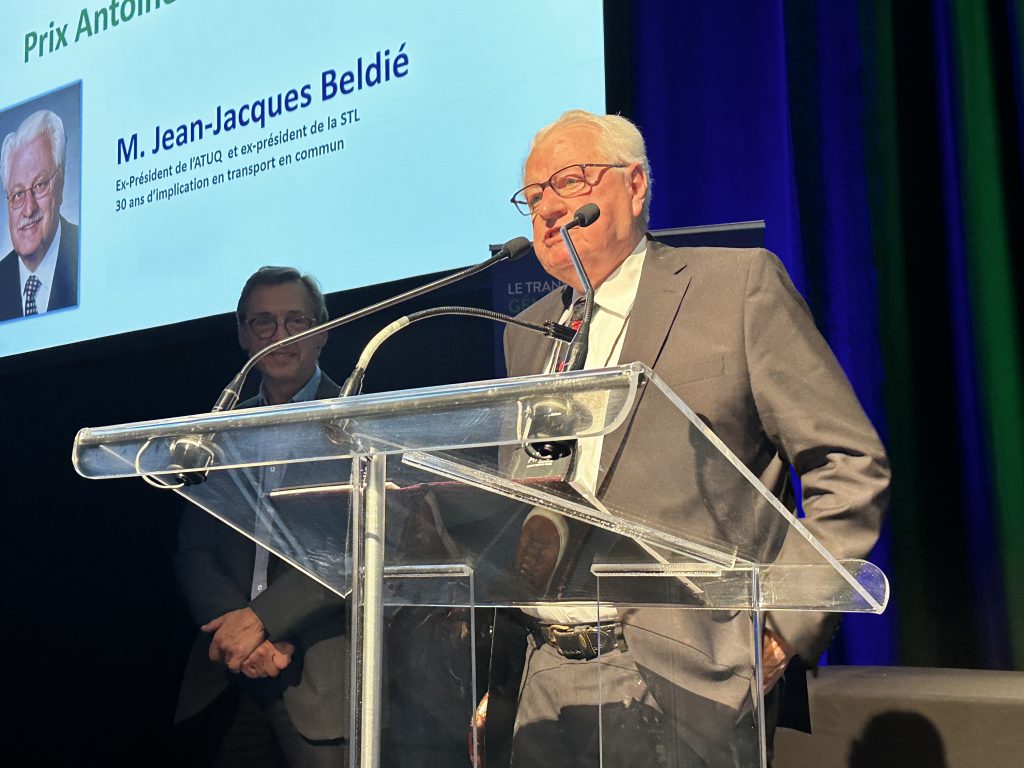
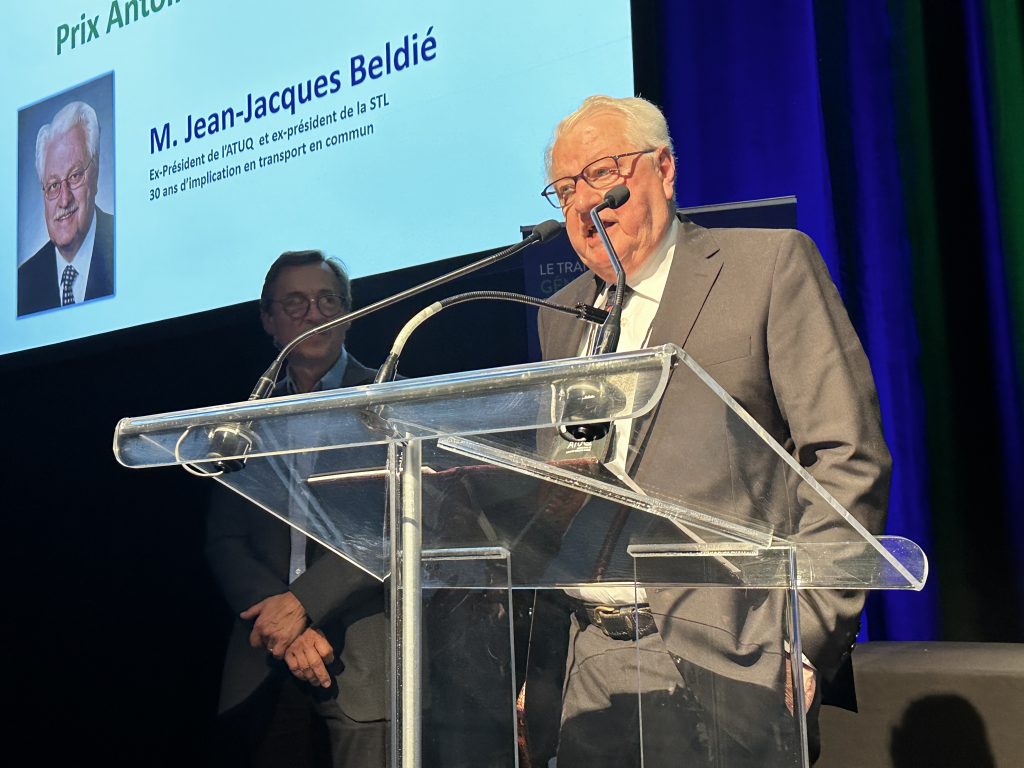
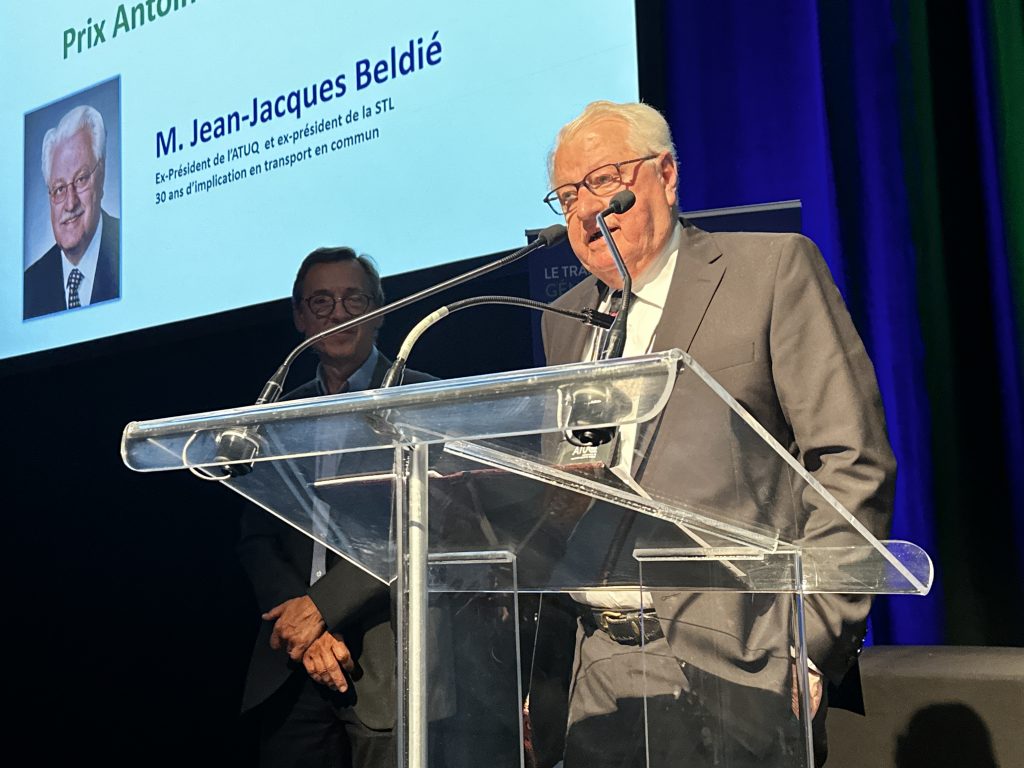
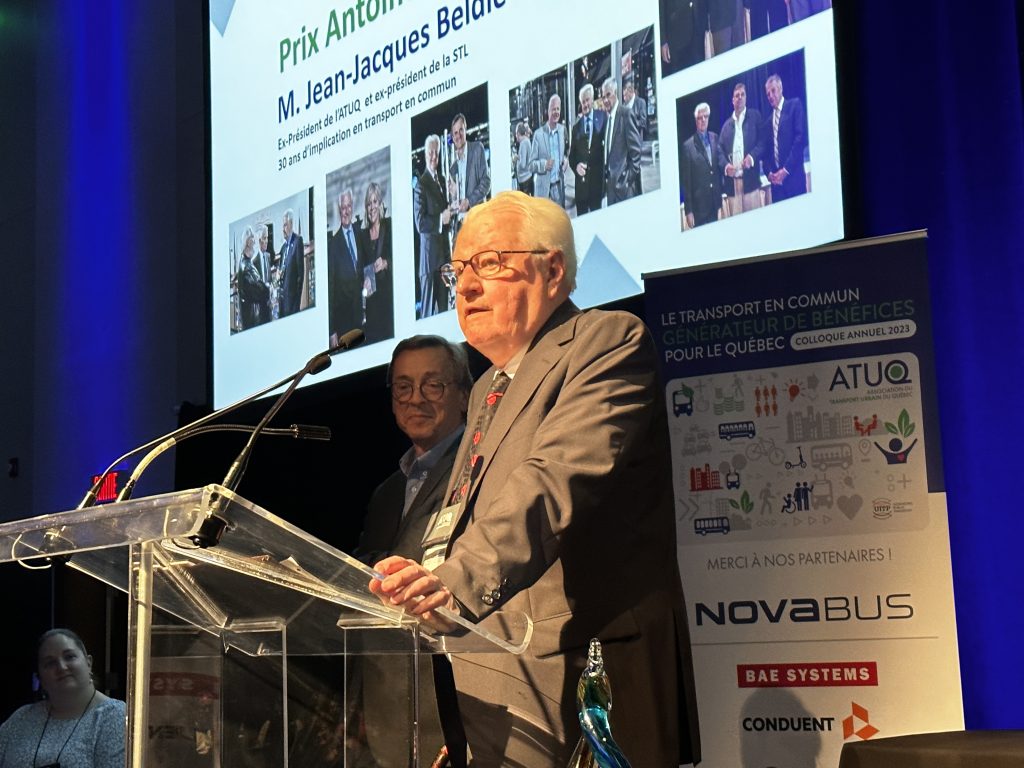



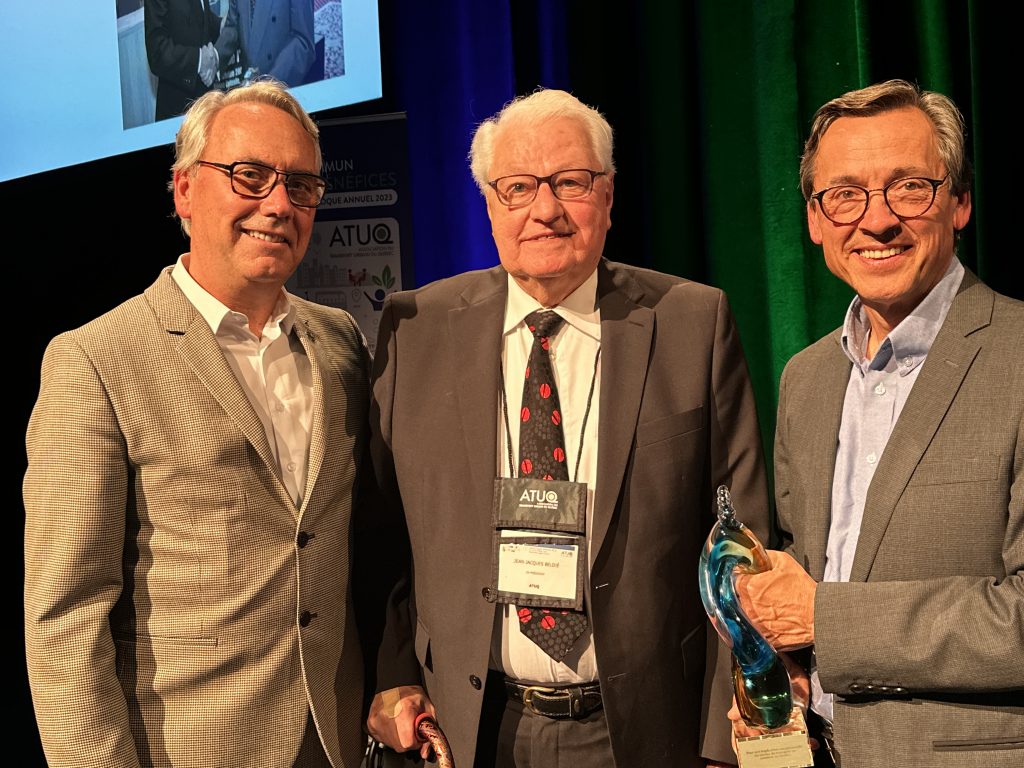
Liste des récipiendaires précédents:
2008 Jean-Marc Rousseau
2009 Claude Martin
2010 Liguori Hinse
2011 Florence Junca-Adenot
2012 Normand Carrier et Pierre Giard
2013 Yves Devin
2014 Pierre Rocray
2015 France Dompierre
2016 Michael Roschlau
2017 Robert Chapleau et Huguette Dallaire
2018 Marie Turcotte
2019 Catherine Morency
2020 François Pepin et Trajectoire Québec
2021 Georges O. Gratton
2022 Benoît Robert
2023 Jean-Jacques Beldié

